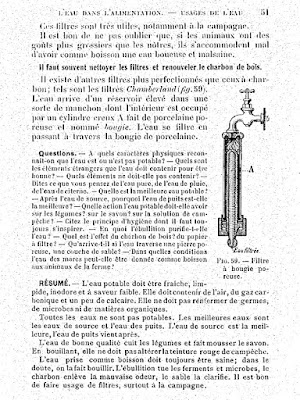Il y
a dans le monde social, et quel que soit l’âge, la condition ou le niveau
d’instruction des individus, différents codes de conduite qui ne concernent pas
seulement l’acquisition des savoirs intellectuels ou l’adoption d’un certain
style vestimentaire, mais qui portent tout autant sur la manière de se tenir à
table, la conduite d’une automobile ou les rituels d’église. Les codes
implicites accompagnant le service à table, que ce soit dans un diner de gala
ou dans une maison bourgeoise, se réfèrent à des pratiques culturelles
supposées intangibles. L’invité, pour tenir son rang, doit montrer qu’il
maitrise certaines techniques corporelles (ne pas mettre les coudes sur la
table…) et qu’il sait utiliser des objets identifiés avec les arts de la
table : couteau, fourchette, serviette… Une personne « bien
élevée » (c’est-à-dire ayant intégré l’ensemble de ces codes de conduite)
saura, par exemple, comment tenir le couteau à poisson pour prélever un filet
ou encore comment glisser délicatement la cuillère dans l’assiette du potage.
Il y a bien sûr aussi une manière de servir le vin dans une carafe, d’utiliser
un certain type de couteau pour couper la viande ou encore de se servir d’ustensiles
spécialisés pour la cuisson (la cocotte-minute, par exemple, l’un des
objets phares des trente glorieuses). Autocuiseurs, robots de cuisson, couteau
à découper la viande, carafe à vin et bien d’autres objets appartiennent à la
culture matérielle de la ‘table’ en France, entendue comme l’organisation du
repas en commun, avec ses rituels et ses présentations. Mais on pourrait aussi
bien désigner ces objets comme représentatifs du statut de la femme moderne,
telle que pouvait la percevoir la société ayant émergé après 1945.
| Deux objets représentatifs de la culture matérielle domestique à différentes époques: l'essoreuse à rouleaux ou calandre et l'essoreuse centrifuge à tambour |
En
suivant Marie-Pierre Julien et Céline Rosselin, on peut dire alors que la
culture matérielle regroupe « l’ensemble des objets fabriqués par l’homme
considéré sous l’angle social et culturel »[1].
Ce
vocable « culture matérielle » appelle cependant des précisions quant
à son utilisation, d’abord dans différents champs de la recherche en sciences
humaines, ensuite dans différentes traditions de la recherche, en particulier
dans le monde anglo-saxon. Cette question nous amènera à effectuer, dans une
première partie, une revue assez large de la manière dont cette problématique
de la création et de l’utilisation d’artefacts a impliqué plusieurs
disciplines, de l’archéologie à l’histoire des techniques. Dans ce cadre il
sera intéressant de confronter les approches fondées sur une vision
évolutionniste de la technique et des objets matériels, à celles qui en France,
autour des auteurs déjà cités et de Jean-Pierre Warnier, se rapprocheraient
plutôt d’un axe anthropologique tournant autour des technologies culturelles.
Dans
une deuxième partie nous nous attacherons à définir les relations entre ces
théories et des études de cas qui permettront de comprendre l’usage social de
certains objets ou de certains dispositifs, en examinant leurs rapports avec
les savoirs incorporés et les acteurs qui les ont accompagnés. C’est ainsi que
nous nous intéresserons au rôle joué par la photographie dans l’accompagnement
de la recherche archéologique au 19ème siècle ; nous tenterons aussi
d’expliciter l’utilisation d’une certaine catégorie d’instrument pédagogique, le
manuel scolaire, dans la culture matérielle de l’école. Ce qui va nous
intéresser à travers ces deux exemples, c’est comment une certaine culture
matérielle agit et transforme les catégories intellectuelles : d’un côté la
recherche des vestiges en archéologie antique et leur représentation par la
photographie ; de l’autre la transmission des savoirs par l’intermédiaire d’un
objet, le manuel scolaire, représentatif de la culture matérielle de l’école.
1.
Objets, sujets
et culture matérielle : une histoire en évolution
Plusieurs
questions sont posées, dès lors qu’on cherche à juxtaposer les deux termes
« culture » et « matérielle ». On peut ainsi se demander,
en suivant M.P. Julien et C. Rosselin, si la culture matérielle n’est qu’un
sous-élément de la culture ou si elle caractérise une discipline particulière,
point de convergence de plusieurs approches. Si ce terme culture matérielle est
une traduction de l’anglais material culture, on remarquera que Fernand
Braudel lui préférait l’expressioin « civilisation matérielle »,
pointant de la sorte l’aspect économique de la vie quotidienne, tout en
conservant un lien avec la culture matérielle de l’anthropologie et de
l’archéologie. Cependant, c’est à Marcel Mauss que l’on doit la distinction en
ethnologie d’une discipline appelée « technologie ». C’est ainsi
qu’André-Georges Haudricourt, en suivant Mauss, donnera la définition suivante
de la technologie, entendue comme « technologie culturelle » :
« l’étude de l’activité matérielle des populations, c’est-à-dire leur
façon de chasser, de pêcher, de cultiver, de s’habiller, de se loger et de se
nourrir. Marcel Mauss inclut dans la technologie, sous le nom de
« techniques du corps », toutes les habitudes musculaires socialement
acquises : façons de marcher, de s’asseoir, de dormir, de nager, de
courir »[2].
On remarquera d’ailleurs que, si dans la tradition française on s’intéresse
surtout aux gestes techniques qui accompagnent la fabrication des objets et
leur manipulation, les Anglais en revanche ont exploré plus largement le
domaine de la consommation.
a.
Le point de vue
historique ou évolutif
Selon
Haudricourt, c’est au 19ème siècle que le point de vue historique
s’est développé dans les différentes spécialités scientifiques, des sciences
naturelles à l’archéologie préhistorique[3]. A
la même époque, des anthropologues anglo-saxons, imprégnés du contexte
évolutionniste de l’époque, vont donner une classification historique des
sociétés d’après leur niveau technique. Ce sera le cas d’E. B. Tylor dans ses Researches
into the early History of Mankind (1865), et surtout de Lewis Morgan dans Ancient
Society (1877). Morgan a fondé la classification des sociétés selon des
critères matériels et défini six stades par lesquels toute société doit passer,
du « sauvage » au « civilisé ». Le passage d’un stade à un
autre est la conséquence d’innovations techniques qui vont constituer des
cultures matérielles spécifiques. Le critère d’évolution pour Morgan n’est donc
pas d’ordre chronologique mais découle de l’état matériel de chaque société.
Objets
matériels et techniques deviennent donc le support d’une analyse évolutionniste
des transformations des sociétés à travers l’histoire. Pour les anthropologues
du 19ème siècle, les sociétés doivent passer par une succession de
stades définis selon des critères matériels. De telles approches peuvent
favoriser une vision déterministe des faits historiques, qu’elle soit d’ordre
biologique ou social. C’est ainsi que Lynn White voit dans l’usage des étriers
les fondements de la création du régime féodal[4]. L’historien
Marc Bloch montre que le développement du système seigneurial doit beaucoup à
l’introduction de la charrue, du collier d’épaule et de l’assolement triennal. Dans
une perspective proche, des paléontologues chercheront à démontrer le rôle
fondamental des objets matériels, qui en faisant des humains des êtres dotés de
prothèses, deviennent les véritables moteurs du changement.
On
n’oubliera pas le rôle d’André Leroi-Gourhan dans l’émergence des théories qui
font de l’usage des outils une des causes du développement des capacités du
cerveau humain, en plaçant ces objets matériels au même niveau que le langage,
la parole articulée découlant en quelque sorte de la posture droite permise par
leur utilisation[5].
Ces théories appelleront nombre de critiques, parmi lesquelles celles qui
considèrent que cette conception de l’anthropogenèse conduit finalement à une
« biologisation » de la technique.
Cependant,
le scénario qui pose l’adéquation entre invention des premiers outils et
hominisation tend à être peu à peu abandonné. Une question demeure
pourtant : elle concerne le passage d’une influence supposée à l’échelle
d’un humain à celle du groupe, puis à l’ensemble d’une population. Une
hypothèse, dérivée de la théorie darwinienne de la sélection naturelle, suggère
qu’une innovation technique peut donner naissance à un phénomène biologique par
élimination des individus dont les gênes en rendent l’adoption trop difficile,
un objet pouvant ainsi participer à l’évolution biologique de l’humanité. La
pensée évolutionniste a admis toutefois certaines adaptations depuis le 19ème
siècle, en passant du strict parallélisme entre les étapes par lesquelles
toutes les sociétés doivent passer dans leur histoire à la reconnaissance de
paliers différents dans l’évolution.
b.
Le
diffusionnisme et l’expansion géographique des traits culturels
Le
passage de l’évolutionnisme au diffusionnisme, opéré dès le début du 20ème
siècle, marque la remise en cause de l’idée d’une évolution linéaire des
sociétés. Les théories diffusionnistes s’intéressent à la distribution
géographique des cultures et aux processus d’acculturation entre groupes
humains. Elles se distinguent également en introduisant les idées de migration,
d’emprunt et d’échanges dans l’étude de la culture matérielle. Fritz Graebner,
en particulier, fonde la Kulturgeschichte (histoire culturelle), qui par
les voies de l’archéologie, de la linguistique et de l’histoire s’intéresse à
la diffusion des traits culturels.
En
Angleterre, Grafton Elliot-Smith et W. J. Perry tenteront de prouver l’origine
unique de toutes les civilisations en rapprochant des éléments présents partout.
Ces théories seront cependant critiquées en raison du caractère mécanique de la
diffusion qu’elles font apparaitre.
En
France, les phénomènes de diffusion sont étudiés principalement par les tenants
du courant de la technologie culturelle. André-Georges Haudricourt explique
l’émergence des techniques par l’héritage des générations passées et les
emprunts à des groupes humains voisins[6].
Le
débat entre évolutionnisme classique et diffusionnisme est cependant loin
d’être tranché. Alors que dans le premier cas les objets sont au centre du
développement, dans le deuxième ils illustrent tout au plus les emprunts d’une
société à une autre.
c.
Technologies
culturelles
C’est
une tradition développée par A. Leroi-Gourhan (1943, 1945), A-G. Haudricourt
(1968), R. Creswell (2010) et les membres de l’équipe de la revue Techniques
et culture, qui ont placé au centre de leurs préoccupations le geste et
l’action sur la matière dans un contexte social, ainsi que le rapport aux
outils et aux objets techniques en général. Cette tradition découle directement
de l’œuvre de Mauss. Pour ce dernier, en effet, une théorie de la culture
matérielle doit déborder la simple technologie culturelle et ne plus s’attacher
à sa préoccupation pour l’action efficace sur la matière. Selon Jean-Pierre
Warnier, qui s’inscrit pleinement dans cette tradition, « s’il est aussi
un travailleur, le sujet est bien plus que cela. Il lui arrive par exemple
d’avoir des pratiques ludiques ou des conduites motrices qu’on ne peut en aucun
cas ranger au nombre des pratiques d’action efficace sur la matière. »[7]
J.P. Warnier cherche à construire une théorie de la culture matérielle en se
référant à Marcel Mauss, pour définir « la matérialité dans son
rapport aux conduites motrices du sujet, comme matrice de
subjectivation. »[8]
Pour cela il préconise de retourner au point de départ que constituent les
« techniques du corps » de Mauss et à la manière dont elles
permettent de penser avec les doigts. Il s’agirait alors de réintégrer toutes
les approches existantes de la culture matérielle. Mais, ajoute-t-il, c’est là
que se trouve la difficulté de l’entreprise. Quelles sont en effet « les
médiations à double sens qui vont de la conduite automobile comme conduite
motrice, à la Citroën DS 19 comme signe analysé par Roland Barthes
(1957) ? »[9]
Selon Warnier, elles résident dans la double articulation du sujet voiture, à
la fois en tant que médiateur dans la conduite et symbole dans la
communication.
Les
approches en termes de technologie culturelle s’intéressent d’abord au geste
technique comme élément d’une chaine opératoire, représentative d’un ensemble
social. Pour Pierre Lemonnier, ethnologue des techniques, une technologie met
toujours en jeu quatre éléments : une matière sur laquelle on agit ;
des objets ; des gestes ou des sources d’énergie ; des
représentations particulières. Ces quatre éléments forment un système, ainsi
que l’a montré Bertrand Gille[10], au
même titre que l’ensemble des techniques utilisées à un moment donné.
Pour
certains ethnologues cependant, l’expression culture matérielle suggère, par
symétrie, une dichotomie matériel/immatériel. On voit bien que l’introduction
de l’informatique dans le commerce a abouti à une double
dématérialisation : celle de la relation marchande et celle de la monnaie.
On peut dire, de la même manière, que de nombreux objets, artefacts majeurs
d’une époque encore proche, ont déjà disparu. C’est le cas de la pellicule dans
la caméra, remplacée par des fichiers informatiques. Pourtant, la caméra
demeure. Et même si certains métiers ont vu leur périmètre reconfiguré et leurs
attributions transformées (le projectionniste dans la salle de cinéma, par
exemple), ils n’ont pas pour autant disparu. On ne manipule plus les mêmes
objets, leur configuration technique a changé. Ce qui ne change pas, c’est la
relation que la culture matérielle entretient avec le sujet, celui que Mauss
désignait comme « homme total », un individu considéré dans toutes
ses dimensions psychologique, biologique et sociale.
2.
La culture
matérielle à l’œuvre : recherche archéologique et transmission des savoirs
à l’école
a.
Photographie et
archéologie antique
Dans
une perspective de recherche sur l’antiquité, archéologues et historiens se
sont très tôt intéressés à l’apport que pouvaient constituer les reproductions
photographiques de monuments et d’objets, en ayant pour objectif la
constitution de collections qui permettraient de conserver une trace visuelle
des sites archéologiques. Au 19ème siècle photographie et
archéologie se développent simultanément, visant pour la première une
description précise de la réalité, pour la seconde une compréhension
approfondie de la pensée antique.
La
photographie prend son essor au milieu du siècle. En 1844, Talbot publie The
Pencil of Nature, le premier ouvrage illustré de photographies originales.
Les photographies sont alors le symbole du réalisme dans un siècle tout entier
tourné vers une certaine idée du progrès technique.
Au même
moment, l’Europe occidentale à la recherche d’un passé glorieux se tourne vers
ses origines. En 1846, Louis-Philippe crée « par reconnaissance pour la
Grèce antique », l’Ecole française d’Athènes, dans le but de voir renaitre
en France la connaissance de la culture de la Grèce ancienne. Quel meilleur
moyen, afin assurer déjà une transmission par le regard, que d’utiliser la
photographie ? Surtout, la photographie permet de reproduire sans erreur,
pense-t-on, des sources cunéiformes ou des hiéroglyphes. On a à l’esprit, à
l’époque, les difficultés rencontrées par les savants qui s’étaient joints à
l’expédition de Bonaparte, en 1798, pour reproduire par le dessin des
caractères qu’ils ne comprenaient pas. La revue Encyclopédie d’architecture
note même, en 1853 : « De même qu’il n’est plus permis aujourd’hui de
faire un projet de restauration d’édifice sans avoir sous les yeux une
photographie de cet édifice, on ne peut plus aujourd’hui étudier sérieusement
l’architecture antique sans posséder des images photographiques des chefs
d’œuvre qui nous restent de cette époque ».
 |
| Chambre à tiroir pliante - Thomas OTTEWILL - 1853 |
Des
voyages sont organisés, un peu à la
manière d’expéditions scientifiques, souvent comme des voyages de découverte
pour écrivains et artistes, et le matériel photographique s’impose très vite à
leurs côtés. En 1851, l’architecte Alfred-Nicolas Normand part pour Pompéi,
Palerme, Athènes et Constantinople, d’où il ramènera 130 clichés – ce qui est
un nombre considérable pour l’époque. Il faut mettre cette quantité en
perspective au regard des moyens dont on dispose aujourd’hui. Au milieu du 19ème
siècle, le photographe doit transporter un matériel considérable en plus de sa
chambre photographique : une valise contenant des produits chimiques pour
révéler et fixer l’image impressionnée sur les plaques, les plaques
elles-mêmes, un support pour la chambre, des outils pour remplacer des optiques
défectueuses, etc. En 1849, Maxime Du Camp, qui accompagne Gustave Flaubert en
Egypte, note : « Apprendre la photographie, c’est peu de chose ;
mais transporter l’outillage à dos de mulet, à dos de chameau, à dos d’homme,
c’est un problème difficile ». La liste du matériel absolument nécessaire
à Gustave Le Gray tient en trois pages, et un autre photographe, Félix-Jacques
Moulin, entreprend en 1856 un voyage en Algérie avec 1100 kg de bagages.
On
voit bien que les contraintes techniques de l’époque sont considérables.
L’encombrement des grandes chambres photographiques n’est pas la moindre. Il
suffit, par exemple, de détailler les caractéristiques d’un modèle proposé en
1853 par Thomas Ottewill, entièrement pliable pour en faciliter le transport et
l’utilisation en voyage : H. 31 x L. 38,5 x P. 85 cm – Poids :
10,1kg.[11]
On est encore loin, on le voit, du Kodak de Georges Eastman ! (voir photo)
 |
| Laboratoire de campagne JONTE & DOMENECH - vers 1870 |
La
lourdeur du dispositif est cependant le meilleur témoignage de la culture
matérielle du photographe et aussi, pour partie, de l’archéologue de l’époque.
Cette culture matérielle, remplacée aujourd’hui peu à peu par des dispositifs
évanescents[12],
est restée longtemps l’apanage du photographe comme figure majeure du témoin et
personnification de l’aventurier au cours du 20ème siècle.
Il
faut maintenant considérer l’autre versant du diptyque, et se demander comment
la photographie a pu intégrer la culture matérielle de l’archéologue. On
remarquera d’abord, qu’à l’époque où la photographie est présentée comme la
possibilité la plus parfaite de réaliser une description fidèle du monde réel,
l’archéologie ne l’utilise que pour des fins de documentation[13].
En revanche, le tournant de la modernité que prend l’archéologie dans la
seconde moitié du 20ème siècle transforme en profondeur
l’utilisation du dispositif matériel par les chercheurs, qui n’ont plus besoin
d’emmener dans leur boite à outils des éléments lourds et dispendieux. Surtout,
la mise en scène réalisée par les photographes du siècle passé n’est plus un
critère important à intégrer dans leurs carnets de recherche. On voit alors
apparaitre deux sortes de photographies d’objets ou de vestiges, comme le
remarque Philippe Collet : « On distingue donc implicitement la
photographie d’œuvres d’art, pour laquelle on admet que l’image ne soit pas
uniquement descriptive, et la photographie scientifique, sur laquelle on doit
« tout voir », sans que le moindre recoin soit laissé dans une ombre
suspecte. »[14]
On
voit que la culture matérielle de l’archéologue a connu un changement
significatif dans la manière de considérer l’apport de la photographie, et ce
changement deviendra encore plus important à mesure que les innovations issues
du traitement numérique des images vont se diffuser dans la recherche. A côté
du photographe spécialisé est apparu un « archéologue-photographe »,
dont l’activité s’apparente à une prise de notes informelle, facilitée par les
très nombreux avantages qu’offre le numérique : simplicité de la mise au
point, récupération immédiate des épreuves, datation et géolocalisation des
clichés.
 |
| Kiosque de Trajan à Philae, J.P. Girault de Prangey 1842-43 |
Différentes
catégorisations des clichés sont effectuées, selon que les photographies
« informent », « montrent », sont « lisibles »
voire même « publiables »[15]. On
retiendra que dans la culture matérielle de l’archéologue, les pratiques de
description et d’information sont désormais séparées entre, d’une part ce qui
relève d’une vision artistique de la photographie et, d’autre part ce qui amène
à la considérer comme l’équivalent d’un outil de prise de note et de
documentation.
b.
Culture
matérielle et éducation : le manuel scolaire et la transmission des
savoirs à l’école.
Un
premier regard sur les objets qui composent l’essentiel des fournitures
scolaires d’une classe du Cours moyen nous renseigne déjà sur la permanence de
certains d’entre eux, toujours représentatifs de la culture matérielle de
l’école, qu’on range habituellement dans la catégorie :
« instrumentation pédagogique ». On pourrait croire alors que les
évolutions technologiques en cours ont finalement peu de prise sur le matériel
scolaire et que la plupart des objets qui équipent l’élève n’ont pas beaucoup
changé depuis un siècle. Le tableau reste le support d’écriture principal en
face de la classe, même lorsqu’il devient numérique car, au fond, son
interactivité est assez limitée. Le livre matérialise et transmet le
savoir ; le cahier est le support de l’écriture de l’élève et demeure le
témoin de sa progression tout au long de l’année ; et on dispose toujours d’une
palette encore plus riche, de crayons, de stylos et d’outils pour écrire et
dessiner.
Si
on continue à utiliser ces objets et à transmettre les mêmes gestes
d’apprentissage, on oublie trop souvent que l’école n’a jamais considéré leur
utilisation comme une finalité et leur forme comme quelque chose d’immuable. On
remarquera que l’enseignement de l’écriture a connu une évolution notable
depuis la plume et l’encrier ; il en est de même pour la lecture, quant au
manuel scolaire, s’il n’a pas été complètement « dématérialisé »
c’est sans doute en raison d’un indéfectible attachement à sa version papier.
Il
est intéressant toutefois de rechercher quelles évolutions ont marqué
l’élaboration du manuel, qui demeure l’objet central de l’instrumentation
pédagogique. Ces évolutions sont en fait de deux sortes. Elles concernent d’une
part la méthode d’exposition de savoirs jugés fondamentaux : l’utilisation
de l’image, la reproduction d’expériences dans le champ des sciences physiques,
le découpage en chapitres et parties qui reflètent une périodisation de
l’enseignement. Elles recouvrent aussi, d’autre part, l’exposition des savoirs
au regard des représentations sociales de chaque époque. Il ne s’agit pas à
proprement parler d’idéologie, mais
certaines catégories apparaissent au gré de l’iconographie et des
classifications, ainsi qu’on pourra le voir dans un manuel de sciences
physiques du cours moyen.
Il
est possible, pour mieux saisir cette évolution, d’effectuer une étude
comparative entre des manuels apparus à deux périodes bien distinctes,
c’est-à-dire au début du 20ème siècle, puis dans les années 1950[16].
Cette périodisation est intéressante car, entre les années précédant la 1ère
guerre mondiale et celles qui suivent la fin de la seconde, on peut constater
des changements radicaux dans les modes de vie, qui sont la conséquence du progrès
technique et de l’évolution des sociétés, dans l’organisation du travail, le
rapport à la hiérarchie, le rôle des femmes, la composition de la famille, etc.
Le
premier ouvrage s’intitule ‘Les Sciences Physiques et Naturelles’ avec
comme sous-titre : « avec leurs applications à l’hygiène – à l’agriculture
– à l’industrie et à l’enseignement ménager » ; il est destiné au
cours moyen et supérieur ; il a été publié en 1911 et il a pour auteurs
Alcide Lemoine et Eugène Fournier. On remarquera d’emblée le champ couvert par
les matières que l’ouvrage se propose d’enseigner : l’accent est mis sur
un rapprochement de la science et de savoirs pratiques que l’on est supposé
apprendre dès l’école primaire. On remarque que ces savoirs pratiques
recouvrent autant l’hygiène que l’enseignement ménager, et il apparait que le
cadre explicatif va s’appuyer en partie sur des conceptions qui reflètent
l’organisation sociale de l’époque.
Changement
complet avec l’ouvrage de Godier et Moreau (M. et Mme). On est en 1958, les
‘Sciences physiques’ sont devenues des ‘Leçons de choses’, avec pour
sous-titre : « exercices d’observation », et la couleur a envahi
tous les visuels de ce manuel destiné au cours moyen. Ici, il est clair qu’il
faut désormais rendre attractif un enseignement qui ne peut pas toujours
s’appuyer sur l’expérimentation. Plus important encore, il y a des types de
représentations qui ont disparu, montrant par là une évolution certaine dans l’organisation
sociale et la réalité du progrès technique en un demi-siècle à peine.
On
peut cependant questionner de manière plus systématique le contenu et
l’organisation thématique de ces manuels. On peut ainsi poser la question des
savoirs et de leur transmission ; on peut aussi questionner la place et la
nature de l’iconographie présente dans ces manuels ; on peut enfin s’interroger
sur les représentations sociales véhiculées à différentes époques et leur
traduction dans la culture matérielle de l’école.
Premières
remarques : Dans le manuel de 1911, présence d’une iconographie organisée
autour de situations représentatives des effets du monde naturel, avant de
procéder à la reproduction par l’image et à l’explication d’expériences qui
vont expliquer ces effets avec une méthodologie scientifique. Exemple : la
question de l’eau dont il s’agit de décrire et de comprendre les trois états.
L’eau s’évapore au soleil et une première image nous montre une femme, désignée
comme la ‘ménagère’, et une petite fille en train toutes deux d’étendre du
linge dans un jardin (p.36). On indique par-là que la chaleur provoque cette évaporation,
et une expérience représentée ensuite montre comment cet élément, l’eau, change
d’état sous l’effet de la chaleur ou d’un grand froid, passant de l’état
liquide à l’état gazeux ou solide. Plus loin, un autre chapitre nous montre
comment l’eau intervient dans l’alimentation (p.48). Ici, la première
représentation est celle d’un chasseur qui s’abreuve à l’eau jaillissant d’une
source. Dans les explications qui suivent, on détaille le principe et
l’utilisation de différents dispositifs permettant la purification de
l’eau : filtre à sable et charbon, filtre avec dalle poreuse, filtre à
bougie poreuse.
On peut
remarquer que la culture scientifique qui est transmise est au service d’une
compréhension de l’environnement technique. C’est donc l’aspect pratique de la
science qui est privilégié, ceci étant sans doute à mettre en relation avec le
niveau du manuel, mais avec aussi la structure sociale de l’époque qui voyait
une majorité de filles et de garçons arrêter l’école après le certificat
d’études. On va donc privilégier des processus faciles à représenter, en
maintenant un lien entre la structure explicative et le monde social.
Ce
manuel nous donne aussi des indications sur la culture matérielle de l’époque, car
les artefacts représentés ici ont pour la plupart disparu de notre
environnement. La production de l’eau potable s’est industrialisée, sa
distribution est assurée sur l’ensemble du territoire et l’utilisation de
procédés de purification ou de pompes à eau est devenue anecdotique.
Le
changement qui apparait dans le manuel de Godier et Moreau est typique de
l’importance des évolutions matérielles et sociales entre les deux époques.
L’entrée de l’électricité dans les foyers tout d’abord, qui a complètement
bouleversé les structures de la vie quotidienne ; l’arrivée d’éléments de
confort, tels que le chauffage central ou l’eau courante à domicile ; la
place des femmes dans la société, qui entrent alors en nombre sur le marché du
travail (ce dernier point explique peut-être la disparition de la figure de la
ménagère qui étend son linge).
La
plupart des objets et dispositifs qui représentaient la culture matérielle du
début du siècle ont disparu cinquante ans plus tard. Cependant, s’il n’y a pas
de changement réel concernant le choix des thématiques et leur présentation, on
remarque que la méthodologie se veut plus proche d’une expérimentation à
coloration scientifique et que les illustrations représentant des scènes de la
vie quotidienne ont complètement disparu. Ont également disparu des chapitres
entiers, tel celui consacré à l’agriculture dans le manuel de 1911. Il faut
probablement y voir un changement dans les objectifs de cet enseignement de
classe primaire puisque, à la fin des années 1950 le niveau communément admis de
sortie de l’école est désormais le baccalauréat. Dans le même temps, la
problématique d’un progrès technique considéré comme résultant des avancées de
la recherche scientifique a probablement eu pour conséquence un changement de
direction dans l’élaboration des contenus du manuel, qui doit désormais
préparer les élèves à la poursuite d’un enseignement scientifique aux
caractéristiques de plus en plus abstraites.
Ces
deux exemples, centrés autour de la photographie et des manuels scolaires, nous montrent que la culture matérielle, loin
d’être une donnée immuable, s’adapte aux contours et au discours dominant d’une
époque, ce qui en fait le reflet de la vie sociale et de l’état des savoirs
véhiculés par les acteurs en leur temps.
[1]
Marie-Pierre Julien, Céline Rosselin, La culture matérielle, p.3, La Découverte,
Paris, 2005.
[2] Ethnologie
générale, p. 731, La Pléiade, Gallimard Paris 1968.
[3] Op. cit.
p.733.
[4] Lynn
White, Medieval technology and social change, Oxford, Clarendon Press,
1962.
[5] André
Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole. Technique et langage, Paris, Albin
Michel, 1964.
[6]
André-Georges Haudricourt, La Technologie, science humaine, Paris,
Maison des Sciences de l’Homme, 1987.
[7]
Jean-Pierre Warnier, Construire la culture matérielle, PUF, Paris 1999.
[8] Op. cit.
[9] Ibid.
[10]
Bertrand Gille, Histoire des techniques, La Pléiade, Gallimard Paris,
1978.
[11]
Références tirées du cours de Delphine Acolat, Photographie et archéologie
antique. Université de Bretagne Occidentale, 2015-2016.
[12] Il
faudrait sans doute s’intéresser à ce que représentent maintenant les selfies,
comme possibilité d’identification culturelle pour différents groupes dans la
société et comme vecteurs d’une nouvelle culture matérielle.
[13]
Philippe Collet, La photographie et l’archéologie : des chemins
inverses, Bulletin de correspondance hellénique, 1996, Volume 120, n°1, pp.
325-344
[14] Op.cit.
p.331.
[15] Marie
Desprès-Lonnet, La photographie de travail dans les recherches en
archéologie, Sciences de la société, n°89, 2013.
[16] En
suivant ici le cours de Sylvain Laubé, Culture matérielle et éducation.
Université de Bretagne Occidentale, 2015-2016.